A l’hôpital Saint-Pierre, le médiateur est trait d’union indispensable entre les médecins et les patients étrangers
Photos: Victoire Becquart
Abdel est l’un des six médiateurs interculturels de l’hôpital Saint-Pierre. Son quotidien est rythmé par les interventions, les annonces, où se mêlent grandes joies et lourdes peines. Immersion dans ce métier méconnu, celui d’un bâtisseur des ponts entre médecins et patients venus de loin.
« Bonjour Madame ! » lance vivement la médecin en entrant dans la chambre. Jusque-là plongée dans la pénombre, la pièce reprend vie. Dehors, le ciel semble mouillé, même si aucune goutte de pluie ne ruisselle aux fenêtres de l’hôpital. Mais la jeune mère, allongée aux côtés de son nourrisson de trois jours, ne réagit pas. Le silence s’installe.
Abdel, resté sur le pas de la porte, décide alors d’entrer. «Salam Aleykoum», dit-il à son tour. A ces mots, le visage de la jeune Irakienne, creusé par une fatigue intense, s’illumine. Elle semble avoir trouvé un repère ? Incomprise jusqu’alors, elle se redresse, hagarde, e regarde Abdel s’approcher vers le bout du lit. Pour ne pas brusquer la patiente avec du jargon médical, il entame une simple discussion. « Enchanté. Je suis Abdel, le médiateur. Toutes mes félicitations Madame! Comment allez-vous? Comment s’appelle votre magnifique bébé ?» Une introduction qu’il s’empresse de traduire à l’équipe médicale. Les deux gynécologues profitent de sa présence pour donner à la mère tous les conseils qu’elles n’avaient pas pu lui transmettre jusqu’à présent. « Vous savez Madame, il serait dangereux d’avoir un autre enfant avant deux ans, cela représenterait un risque pour la cicatrice de la césarienne… ». Après seize ans de métier, Abdel sait bien comment adapter le discours des médecins, sans toutefois l’altérer. Certains sujets ne sont, en effet, peuvent s’avérer sensibles. La gynécologie, la mort, la sexualité ou le rôle même du médecin ne se vivent pas de la même manière dans toutes les cultures.
Cette complexité dans la communication est ce qui passionne Abdel, dont le rôle dépasse largement celui d’un simple traducteur. Il est l’un des six « médiateurs interculturels hospitaliers » engagés à Saint-Pierre, chargé de l’arabe et de ses dialectes. Ses collègues, eux, sont responsables du polonais, du turc, de l’albanais, du russe ou encore du roumain. Ils sont 125 en Belgique, 63 francophones et 62 néerlandophones. Dans cet hôpital, connu comme le plus multiculturel de la capitale, leur rôle, invisible du grand public, est absolument primordial.
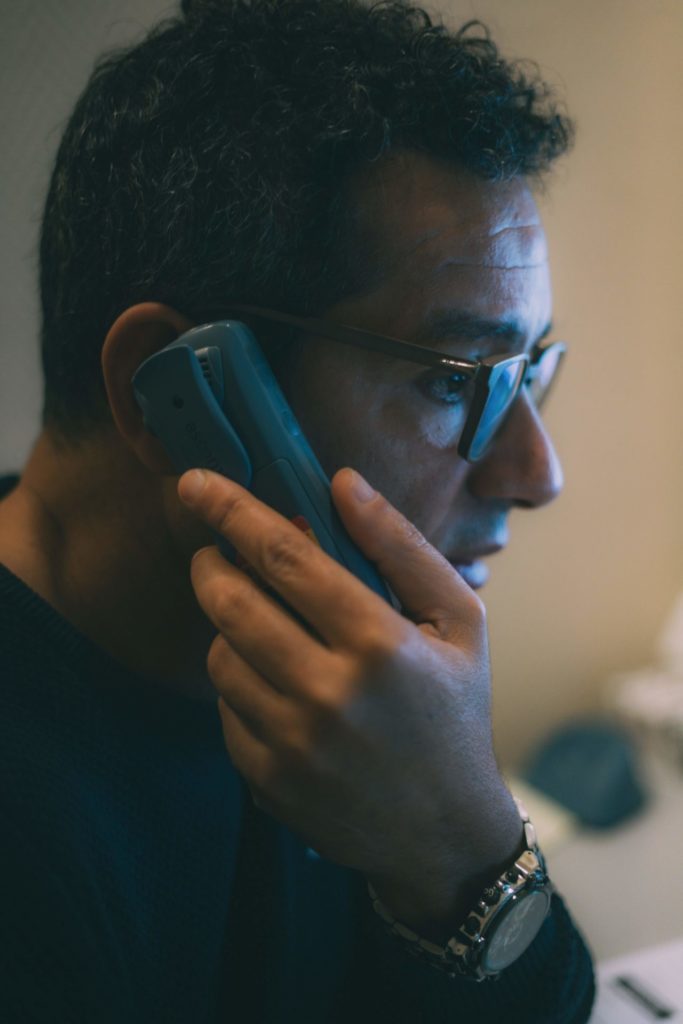
Émotion quotidienne
Son « dect » – le téléphone dédié aux demandes de médiation – solidement fixé à sa ceinture, Abdel arpente inlassablement les couloirs de cet hôpital dont il connaît chaque recoin. Même quand on ne l’appelle pas, il a pour habitude de se balader de services en services pour proposer son aide. Tout le monde le connaît ici. Il faut dire que l’intensité émotionnelle de certaines médiations a créé des liens avec de nombreux médecins. Au fil des années, il a tissé de belles amitiés. Ses moments d’accalmie lui sont chers, tant il sait qu’ils ne durent jamais longtemps. Généralement, il ne faut pas dix minutes pour que son dect ne se remette à biper. Il est 12h45 en ce mercredi de fin novembre. Abdel en est à sa quatrième intervention. Alors qu’il s’apprête à aller manger, il reçoit un appel. Direction le service d’oncologie, à l’autre bout de l’établissement. Abdel marche à vive allure, enjambe les marches deux par deux. Il faut faire vite, il n’aime pas se faire attendre. A peine essoufflé, il arrive enfin dans le cabinet où le médecin et son patient, un réfugié d’origine irakienne, l’attendent. Le docteur a la mine grave. Il doit annoncer une mauvaise nouvelle à l’homme d’une cinquantaine d’années: une troisième récidive, très agressive, de son cancer du foie. Abdel fait tampon. Par des gestes, des expressions, il s’adapte à l’homme qui se trouve en face de lui. Lui-même immigré marocain, arrivé en Belgique pour poursuivre ses études il y 20 ans, il sait que son parcours est une force qui l’aide à comprendre certains patients. L’homme souffle, son regard se perd dans le vide. « Ça veut dire que je vais très mal ? » demande-t-il abattu. La voilà, l’intensité émotionnelle dont Abdel parlait.
Briller par son absence
En plus d’être au cœur des plus belles interventions comme des plus difficiles, les médiateurs sont aux premières loges des mouvements migratoires. Il y a 16 ans, quand Abdel est arrivé à Saint-Pierre après des études dans le social, la guerre d’Irak venait de commencer. Les années suivantes, il a vu le nombre de patients irakiens. Aujourd’hui, avec la guerre à Gaza, ce sont les Palestiniens qu’il rencontre par dizaines chaque semaine. A chaque fois, il apprend beaucoup avec ces patients venus de loin. Nouvelles cultures, nouveaux mots, nouveaux dialectes. Nouvelles réalités aussi. Comme lors de cette matinée dont le calme fut interrompu par un appel des urgences. Abdel était à son bureau en train d’encoder, comme tous les matins, les médiations réalisées la veille. Cas, durée de la médiation, genre, âge et origine du patient… C’est une des obligations des médiateurs : rendre des statistiques annuelles pour l’hôpital. Une tâche chronophage, mais qui doit permettre, à terme, de faire ressortir des données intéressantes. Ce matin-là, pas le temps de terminer. Ni une, ni deux, Abdel s’empare de son dect, badge les portes plus vite que son ombre et dévale des escaliers qui mènent aux urgences. Il ne connait encore rien de l’intervention qui l’attend. Victor, l’assistant social, n’a pas eu le temps de le lui communiquer au téléphone.
La subtilité de mon métier se trouve dans l’invisibilité dont je dois faire preuve.
Les urgences sont un service à part dans l’hôpital. Dans les couloirs constamment surpeuplés, on marche entre les brancards de patients qui attendent leur prise en charge, on entend crier, pleurer, et l’odeur est parfois difficile à supporter. Ces scènes de détresse physique et psychologique, Abdel en a fait son quotidien. Victor arrive à sa rencontre et en profite pour le briefer brièvement tout en trottinant. « C’est un monsieur d’une trentaine d’années qui est arrivé en Belgique il y a trois jours avec son frère. Ils viennent de Gaza. Ils sont à la rue et l’homme se plaint de maux de tête intenses à la suite d’un choc survenu là-bas. J’aimerai m’entretenir avec eux pour savoir où ils comptent aller après la prise en charge, s’ils ont des solutions… ». Sa phrase tout juste terminée, les voilà déjà dans la chambre. L’ambiance est lourde. L’homme se tord de douleur sur le lit. Il tient sa tête entre ses mains et semble très affaibli. Son frère le regarde assis sur le siège à côté de lui, impuissant. Leurs chaussettes sèchent sur un petit radiateur près du lit. Le petit coffre-fort dans l’armoire est ouvert, il n’y a rien à mettre dedans. Victor se présente et Abdel lui emboite le pas. « Bonjour. Je suis Abdel le médiateur et je suis là pour vous écouter ». Le frère le regarde et, désemparé, explique leur situation. « Je vous en supplie, donnez-nous un toit. Dormir dans la rue est trop dur, il fait très froid et mon frère est souffrant ». Victor leur explique la marche à suivre et leur promet de faire tout son possible pour les aider. L’échange est pesant. Après de longues minutes d’explications détaillées sur les démarches possibles, Abdel s’approche de l’homme et pose sa main sur son épaule. « Courage », lui souffle-t-il. «Victor connait des gens, il va vous aider». Le dect sonne et c’est déjà l’heure de repartir.
Sur le chemin, Abdel explique : « Il est important de ne pas se positionner comme l’avocat du patient. Malgré les situations parfois très complexes comme celle qu’on vient de vivre, je laisse les patients prendre leurs responsabilités et je fais attention à ne pas les materner. Je les laisse réagir comme ils le sentent, sans les influencer». Tout en entrant dans l’ascenseur qui mène au service pédiatrique, il ajoute humblement : « La subtilité de mon métier se trouve dans l’invisibilité dont je dois faire preuve. La relation médecin-patient ne doit en aucun cas être altérée, simplement facilitée. Le médiateur doit briller par son absence, ne pas être une entité à part entière ».

Le choc des cultures
Les médiateurs doivent non seulement traduire les dires des médecins, mais aussi les rendre intelligibles par le patient. Ils prennent le temps d’expliquer, d’utiliser des références communes et de faire des comparaisons. Avec l’expérience, ils accumulent un savoir médical impressionnant. Abdel trouve cela passionnant. Il est capable, par exemple, de reconnaître la galle d’un coup d’œil ou encore d’énumérer tous les moyens de contraception possibles, sans que le médecin n’ait à le lui faire traduire.
Il faut savoir s’adapter au psychisme et aux références culturelles du patient. Notre métier est fondamentalement humain, c’est bien plus que de la traduction
C’est d’ailleurs ce qu’il a fait lors de la médiation avec la jeune mère irakienne et son nourrisson. Lors de cette intervention, qui avait touché à l’intime, il était étonnant de constater la confiance qu’avait rapidement donnée la mère à Abdel. Sa condition d’homme a-t-elle déjà représenté un frein pour certaines femmes ? Pour le bien de la médiation, il se doit d’être présent durant toute la consultation. Mais qu’en est-il des interventions gynécologiques par exemple ? « Il est rare qu’une femme refuse ma présence parce que j’ai appris à ne plus représenter l’« homme » que je suis mais seulement le médiateur, l’aidant ». Son effacement va jusque-là. Quelques jours plus tard, une situation vient l’illustrer.
9h30, Abdel est dans bureau. Il s’occupe de traiter les demandes anticipées de médiation pour des langues que son équipe ne maîtrise pas. Il en arrive des dizaines chaque jour. Pour chacune d’entre elles, l’équipe s’occupe à tour de rôle d’engager un médiateur externe à l’hôpital via « SeTIS », une plateforme créée à cet effet. C’est aussi leur rôle. Ce sont des interventions que l’hôpital paie entre 40 et 50 euros. «La moindre erreur est donc relativement couteuse » explique-t-il. « Hier encore, un patient, pour lequel j’avais sollicité un médiateur SeTIS, n’est jamais venu. Problème de communication. Et l’hôpital a payé dans le vide… ». Abdel est concentré… jusqu’à cet appel. Son dect sonne, c’est le service de planning familial. Il décroche et demande simplement : «Quel est le nom de cette dame ?». Cette question n’est pas anodine. Connaître cette information lui permet d’anticiper le dialecte arabe à utiliser. « En effet, dit-il, chaque nom est connoté ». Trois minutes plus tard, il est trois étages plus bas, aux côtés des secrétaires qui l’avaient appelé. Une femme est assise dans la salle d’attente, incapable de communiquer avec le personnel. Elle tient une poussette dans laquelle un bébé dort paisiblement. Abdel se présente, la femme se lève et s’approche du comptoir. Elle semble exténuée. Gênée de parler, ses yeux fixent le sol. Abdel le comprend aussitôt et la rassure. « Comment allez-vous ? Vous avez le teint pâle, vous paraissez très fatiguée. Je vous en prie, asseyez-vous ». La femme chuchote. Elle vient pour une IVG. Elle ajoute qu’elle se sent extrêmement coupable. Les secrétaires, soutenu par Abdel, lui rappellent alors qu’elle est libre de son corps et de sa vie et que personne ne peut la juger. La secrétaire lui demande son numéro de téléphone et Abdel, la voyant réticente, ajoute que si ce n’est pas elle qui répond la première, ils ne diront rien. En partant, il mentionne la « compréhension interculturelle » qu’a nécessité l’intervention, notion omniprésente dans son métier. « Il faut comprendre que cette femme, en faisant cette démarche aujourd’hui, se met réellement en danger. Sa culture est très patriarcale, c’est l’homme qui prend les décisions. Si son mari l’apprend, cela pourrait être catastrophique. D’autant plus, si cela s’ébruite autour d’elle, dans sa communauté, elle pourrait être violemment rejetée. Tout cela, je le sais, et je dois composer avec. Je dois adopter une attitude spécifique et proposer, avec les secrétaires, des solutions adaptées. Il en va de sa sécurité».
Au bout du fil
En plus de la médiation interculturelle physique, les médiateurs travaillent également à distance, par visio-conférence ou simple appel téléphonique. Un planning horaire prévoit un temps obligatoire où, toutes les semaines, chaque médiateur se doit d’être disponible en ligne pour répondre aux demandes externes. En effet, de nombreux hôpitaux et autres centres médicaux ne peuvent pas s’offrir le luxe de médiateurs à domicile. Une matinée par semaine, Abdel s’enferme donc dans le petit bureau prévu à cet effet, face à sa webcam. Régulièrement, on lui demande aussi de passer des appels téléphoniques avec des patients : prise de rendez-vous, résultats d’analyse…
Ce jeudi après-midi, Abdel est appelé par la maternité pour s’entretenir avec une ancienne patiente. Quand il arrive sur place, l’assistante sociale lui explique que la mère qu’ils souhaitent appeler vient de perdre son bébé in utero, quelques jours auparavant. Par cet appel, ils veulent discuter avec elle du devenir du petit corps. Pendant une dizaine de minutes, et dans un silence presque religieux, Abdel s’entretient avec la femme endeuillée. Une discussion bien lourde pour être faite au téléphone, d’autant plus qu’elle omet le non-verbal, pourtant essentiel en médiation.
Ce jour-là, Abdel a mené à bien plus de dix médiations différentes. Dix patients, et autant de problématiques, jargons médicaux et émotions différentes. Sans oublier qu’entre chacune d’entre elles, il court. « Certains jours, il m’est arrivé de ne pas pouvoir manger avant 15h » confie-t-il. Cela pose question. Comment fait-il pour tenir le coup, physiquement comme mentalement ? « Certes, je suis parfois fatigué en fin de journée, surtout celles où les interventions s’enchaînent» avoue-t-il, en regardant les chiffres des étages de l’ascenseur défiler. «…mais la passion pour mon métier reste, elle, infatigable». « Ding». Les portes s’ouvrent. Et avec elles, la vision altruiste qu’il nourrit un peu plus chaque jour.


